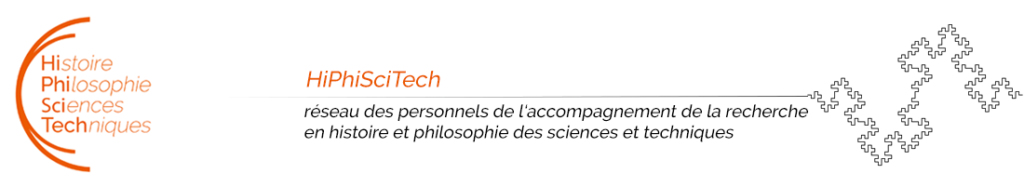|
Différent de l'auto-archivage réalisé par les auteurs, un dépôt sur ces plateformes fait l'objet d'une validation par une commission en relation avec l'établissement de soutenance et est pris en charge par une instance mandatée (Service Commun de la Documentation ; Direction de l'Appui à la Recherche ; Bibliothèque ; ...). |
DUMAS
-> Lien vers DUMASPlateforme de "Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance" Derniers mémoires recensés
Après avoir été effrayé à l’idée de voyager par plaisir en raison de la connotation guerrière de cette dernière mais également d’une peur des reliefs naturels, une nouvelle perception renverse à la fin du XVIe siècle cette pensée. La conception utilitaire du voyage prend l'ascendant au cours du siècle suivant, avec la possibilité d'apprendre et de se forger une culture personnelle jugée essentielle aux nobles de cette époque. Cette conception évolue à nouveau grâce à l'influence des Lumières et de nombreuses découvertes scientifiques ou philosophiques du XVIIIe siècle. La pratique voyageuse est maintenant comprise comme un moyen de connaître la terre, de partager les savoirs pour une plus grande égalité. Dans ce contexte, les scientifiques sont devenues des acteurs centraux, notamment en se rendant directement sur les lieux à expertiser. Ainsi, en plus d'une large publication d'imprimés de relation de voyage fait par des nobles en mission diplomatique ou dans la réalisation de leurs Grands Tours, se développent en parallèle des mémoires scientifiques tirés de leurs voyages. Dans la même période, un nouvel acteur dans le chaînon de l'imprimerie vient bouleverser l'ordre établi au siècle précédent, les périodiques. C'est avec ce nouveau support que les savants-voyageurs ont diffusé non seulement des extraits de leurs mémoires mais également des lettres, des synthèses et des questionnements portants sur les avancées scientifiques. Dans ce microcosme où vivent savants et acteurs de l'impression, de nombreux d’échanges et interactions s’étiolent, tels que des demandes d'instructions spécifiques ou d'aide particulière pour récupérer divers échantillons provenant d'une région lointaine. Cet ensemble se représente également à travers le carnet, un outil essentiel à la sauvegarde des pensées du voyageur qui le suit en toutes circonstances au cours de ses trajets. C'est avec cette source que ce mémoire se propose de retracer la méthodologie d'un savant-voyageur au tournant du XVIIIe siècle en la personne du chevalier Déodat de Dolomieu. Au travers de ses carnets se dévoile les traces de sa pensée savante et des évolutions de cette dernière au cours de ses pérégrinations, permettant la reconstruction d'une méthodologie propre à ce dernier. De même, elle permet la sauvegarde des humeurs de son propriétaire au cours de ses trajets mettant en lumière sa perception de la pratique voyageuse. Enfin, ce même objet se révèle être l'outil le plus essentiel à la propre compréhension de sa conception aux yeux de son propriétaire, ainsi que de pouvoir distinguer si cela est réellement nécessaire les propriétés entre une relation de voyages pour son plaisir et celui d'une relation savante faite pour autrui.
Notre projet de mémoire, ci-dessous développé, est le suivant : comment étudier la notion d'émergence dans le cadre de la métaphysique anglo-saxonne contemporaine ? Pour répondre à cette question, notre réflexion partira du système ontologique particulier, à savoir le "carré ontologique", d'inspiration aristotélicienne et repris par un auteur contemporain, E.J. Lowe. Dans ce système, les catégories ontologique d'"objet", de "phénomène", de "propriété" et de "condition" sont analysées comme étant fondamentales, irréductibles et suffisantes pour décrire tout le contenu de la réalité. Nous nous sommes limités cette année à la présentation de ce système, espérant par la suite pouvoir le développer dans le sens d'un physicalisme non réductif. Notre thèse finale sera alors la suivante : il est possible que de nouvelles conditions émergent.
Nous proposons à travers ce travail de regarder la pensée philosophique comme étant essentiellement liée au phénomène d'ἀνάμνησις, c'est-à-dire au ressouvenir ou à l'anamnèse. Nous cherchons à repenser le propre du philosopher. Dans cette optique, philosopher signifie "se ressouvenir". Pourtant, l'anamnèse n'a pas affaire à la mémoire et aux souvenirs. Elle est expérience, à travers laquelle adviennent une vérité et un savoir. Notre point de départ se trouve dans une évidence de la pensée philosophique : la pensée a une histoire et s'enracine dans une tradition. Tout ce qu'on met devant la pensée, tout ce que la pensée prend comme tâche a un lien avec ce qui a été pensé auparavant ou fait référence à ce qui a été, qu'on l'admette ou non. Nous identifions, cachée sous la forme de cette évidence, une tendance de la pensée philosophique qui n'a pas été mise en question ou explicitée. Ainsi, philosopher c'est dans un certain sens se retourner vers le passé afin de le reprendre sous un jour nouveau. Ce point de départ trouve sa confirmation philosophique à travers une analyse "historique" : l'anamnèse chez Platon et Gadamer. C'est à travers cette façon de mettre à l'œuvre ce que l'évidence nous a dévoilé qu'on découvre que l'anamnèse décrit la recherche et la découverte de type philosophique. Pour Platon, l'άνάμνησις représente moins une actualisation d'un savoir tout fait, inné et latent, qu'une manière de reprendre quelque chose de "su" sous un jour nouveau. C'est donc ce mouvement "rétrospectif" qui rend possible le savoir et la vérité pour la pensée philosophique. Selon Gadamer, l'άνάμνησις platonicienne s'apparente à une re-connaissance. Ces deux analyses dévoilent une certaine "structure" que possède l'anamnèse, un certain mode d'être : elle se définit par le "re-". Il s'agit d'un re-vivre, re-connaître, re-conquérir, re-voir "à distance" la réalité. Ceci renvoie à l'idée de "voir" les choses "dans une autre lumière", ou faire une nouvelle expérience des choses qui apporterait un surcroit de connaissance. Le "re-" de l'anamnèse désigne le fait de re-faire une "expérience". L'anamnèse représente une expérience du philosopher. Philosopher et parvenir à un savoir signifie, dans ce sens, faire l'expérience de l'expérience.
Le débat sur la nature de la relation entre écologie et écologisme repose principalement sur des présupposés épistémologiques quant au statut de l'écologie et quant à la façon dont elle doit prendre en compte les activités humaines. L'écologie peut être considérée comme une partie de la biologie, comme une science naturelle interdisciplinaire, ou comme une science interdisciplinaire qui fait le pont entre sciences de la nature et sciences de l'homme. La prise en compte de la spécificité culturelle de l'homme dans son rapport aux écosystèmes et à la biosphère dépend donc du statut que l'on donne à l'écologie.
Cette étude tente de répondre à la question "qu'est-ce que le jazz ?" en partant des spécificités musicologiques propres à cette musique pour rejoindre la pensée sociale et culturelle du jazz. Plus qu'un simple travail de définition, il s'agit d'analyser le jazz pour en extraire ses valeurs, d'interpréter les phénomènes musicaux jazzistiques en les plaçant toujours déjà dans un contexte historique et social déterminé. Penser le jazz, c'est établir son unité esthétique. Pourtant, on n'épuise pas le phénomène jazzistique à parler de swing et de sonorité : penser le jazz c'est aussi comprendre les origines musicales d'une telle musique et donc utiliser une méthode généalogique permettant de comprendre pourquoi, un jour, des hommes ont joué de la musique de telle manière. Le discours musicologique s'ouvre à la philosophie sociale et aux sciences historiques. Penser le jazz, c'est alors comprendre qu'il est une musique populaire, issu de la rencontre brutale des musique occidentale et africaine dans le contexte de la ségrégation raciale. Si certains discours sur la musique font de l'abstraction leur crédo, un discours sur le jazz semble devoir nécessairement prendre en compte les contextes socio-historiques dans lesquelles on joue du jazz. Le jazz se joue, se danse, s'incarne dans des gestes, des attitudes et des corps, et ce faisant, véhicule une pensée musicale que l'on ne peut pas comprendre si l'on s'en tient à une analyse musicologique. Penser le jazz comme pensée, ériger le jazz en porte d'entrée privilégiée d'une culture américaine naissante, comprendre l'encrage de la musique de jazz dans la Weltanschauung américaine sont les enjeux de cette étude qui donne en outre des pistes tant méthodologiques que généalogiques pour entreprendre une analyse des musiques populaires postérieures au jazz.
S'interroger sur le clonage, c'est s'interroger sur ce qu'il produit, à savoir le clone, le double, dont il s'agira pour nous d'appréhender le sens et de voir en quoi cet être recréé, reproduit par clonage présente une figure complexe, en quoi il représente un être particulier, au statut quelque peu singulier. Il importe donc de définir ce que signifie, ontologiquement et symboliquement, l'action même de cloner et de définir ainsi ce que signifie l'existence d'un clone. En effet, la question du clonage ne peut être séparée de la question même du clone puisque sans clone, il n'y aurait pas lieu de parler de clonage. Par ailleurs, il nous faut définir ce qu'est scientifiquement le clonage. Nous montrerons alors que les définitions mènent parfois à des quiproquos et des illusions qui n'ont pas lieu d'être une fois le terme clairement défini.
Les derniers écrits (1946-51) de Wittgenstein s'occupent principalement de philosophie de la psychologie et s'attaquent à certaines théories classiques de l'esprit, que les commentateurs qualifient de mythologies. Notre travail consiste à évaluer la possibilité de la présence de ces mythologies de l'esprit à l'intérieur des théories construites par les sciences psychologiques ainsi que les implications sur la psychologie que cette présence est susceptible d'avoir. En nous appuyant sur certains des points centraux de la critique wittgensteinienne (l'usage ordinaire, la distinction conceptuel / empirique, etc.), nous montrons qu'il est envisageable de dégager des thèses, d'inspiration wittgensteinienne, délimitant les prétentions de la psychologie. L'œuvre de Wittgenstein fournirait donc un outil, dans une mesure que nous nous efforçons d'apprécier, pour une mise en débat de la scientificité de la psychologie, en particulier des neurosciences cognitives.
Ce mémoire s'intéresse aux collaborations possibles entre Intelligence Artificielle et philosophie. Il montre que les deux disciplines peuvent partager des objets, des théories et des résultats pour apprendre l'une de l'autre. La stratégie de ce mémoire consiste à expliciter des relations épistémologiques entre les problématiques propres aux deux disciplines ("IA faible" et "IA forte"), afin de définir des modes de collaboration sur le plan disciplinaire. La deuxième partie de ce mémoire présente les travaux de philosophes et de spécialistes de l'IA, depuis les débuts de l'Intelligence Artificielle jusqu'aux années 80. Elle expose les démarches collaboratives exploitées par ces chercheurs, de manière implicite ou explicite. La troisième partie présente des travaux où la philosophie sert de socle conceptuel à l'Intelligence Artificielle, notamment en ce qui concerne la simulation de phénomènes émergents. La quatrième partie réalise un renversement des relations classiques entre les deux disciplines. C'est au tour de l'Intelligence Artificielle de se mettre au service de la philosophie, en formulant de nouvelles hypothèses de recherche ou en testant les théories philosophiques à partir de cas concrets. Ce mémoire, enfin, espère œuvrer pour le rapprochement des deux disciplines et ainsi encourager philosophes et spécialistes de l'IA à collaborer sur les sujets qui leurs sont chers.
À la fin du XIXe siècle, les conceptions philosophiques classiques des sciences physiques ont été bouleversées par certaines avancées scientifiques. En effet, juste avant le renouveau de la physique induit par les deux théories de la relativité d'Einstein, l'essor des géométries non-euclidiennes et la théorisation de l'imprévisibilité de certains systèmes dynamiques déterministes ont donné lieu à des débats philosophiques houleux : que faire de l'a priori kantien et du libre arbitre après ces découvertes ? Ces débats philosophiques basés sur des questions scientifiques sont principalement développés dans des articles de revues, qui se répondent mutuellement. Pour étudier ce corpus, il a fallu identifier les discussions, les structurer et les situer.
|
TEL
-> Lien vers TELServeur de "Thèses en Ligne" et HDR Dernières thèses ou HDR recensées
Cette thèse comporte trois parties. La première décrit la constitution de l'écriture symbolique mathématique, pour l'essentiel achevée avec la Géométrie de Descartes. Dans la seconde partie, l'auteur examine certains motifs "transcendantaux" de la connaissance organisés par le nouveau système. Enfin, il analyse le rôle de la symbolique nouvelle dans l'invention et la création d'objets. La première partie, "Le système", décrit la naissance du symbolique, entraînant l'organisation de deux registres, combinatoire et signifiant. Tout s'est joué entre 1591 et 1637, c'est à dire entre l'Isagoge de Viète et la Géométrie de Descartes. Après avoir décrit, de Diophante à Cardan les systèmes rudimentaires préalables, grecs puis médiévaux, tel le cossique avec ses apories, l'auteur analyse les six points qui se révélèrent essentiels à cette constitution : la représentation du requis (la ou les inconnues), du donné (avec pour conséquence la "littéralisation" du texte), celle des opérations (par le moyen des assembleurs), des puissances (l'exponentielle cartésienne), de la mise en relation par égalité (tel la 'Boucle'cartésienne), enfin la ponctuation du texte symbolique. Sur trois de ces rubriques, la contribution de Descartes fut décisive. Ainsi, de Viète à Descartes, l'écriture symbolique mathématique s'est constituée, revêtant les aspects principaux de sa structure actuelle. La seconde partie "Symbolique et invention" est d'abord organisée autour de Leibniz et de sa rencontre en 1676 avec l'Epistola Prior de Newton et un lot de questions combinatoires et signifiantes. Le chapitre "Charactéristique et Nouveau Calcul" décrit Leibniz créant son Algorithme fondamental, initialement par le seul "jeu combinatoire" des substitutions, hors de toute signification. Dans "L'Art combinatoire. Substitutions et métamorphoses", le concept s'élargit, parvenant à sa forme moderne : un outil de l'invention mathématique ancrée dans le symbolique. "Formes sans significations" décrit enfin un méta-procédé de construction d'objets à partir de leur "forme", d'abord analysée dans les échanges de 1676 entre Leibniz et Newton, puis dans la création du corps des nombres complexes dénouant l'énigme des "quantités imaginaires" de Bombelli. La méthodologie se compose du choix des "canons électifs" et de la procédure canonique. Quant à l'énoncé du "principe", il est simplement le suivant : "tout objet, toute formule mathématique, apparemment en soi, peut le cas échéant être regardé comme une instance seulement d'un objet ou un canon plus vaste qui le recouvre et le prolonge sur le plan signifiant, cependant que sa forme symbolique reste inchangée". L'auteur examine ensuite diverses réalisations de ce schéma épistémologique, tant chez Euler (exponentielle complexe et "factorielle" neuve) que récentes (distributions de Laurent Schwartz), ainsi qu'un exemple tiré de sa recherche personnelle (quasi-ensembles). L'auteur évoque les problèmes soulevés par la terminologie et propose des solutions. Le discours mathématique quotidien, écrit ou parlé, s'accompagne d'une confusion entre signifiant et combinatoire, ou encore chose et symbole, une distinction qui n'est pas usuellement inscrite, même dans l'écrit, et toujours de cette même façon : c'est le représentant qui est confondu avec le représenté. Une confusion délibérée qui vient s'accomplir dans la complète absence d'une terminologie combinatoire" pour le vocabulaire des mathématiques usuelles et opératoires (livres, manuels, articles), qui fait preuve sur ce point d'une effarante imprécision quant au registre véritablement concerné. Ainsi, de "terme" ou de "membre" (d'une équation), d'"expression", de "couple", ou encore de "formule", qui peut renvoyer indifféremment dans le même texte au contenu (un résultat, le plus souvent universel) mais aussi à la forme (une concaténation de signes). Le vocabulaire usuel des mathématiques suscite ainsi à l'évidence un nombre considérable de semblables situations. Or la division signifiant-signifié paraît indispensable à toute analyse épistémologique, historique, ou didactique. L'auteur s'est donc donné pour tâche de pallier dans un certain nombre de cas le manque de termes spécifiques en provenance du registre combinatoire. Notes : L'ouvrage comporte de nombreuses références, en particulier aux travaux de : Bernoulli, Bombelli, Cajori, Cardan, Diophante, Euclide, Euler, Heath, Newton, Stiefel, Tschirnaus, Viète, Wallis. Il comporte deux types d'index : l'un des auteurs, l'autre des sujets.
Scientifique, impersonnelle, dépassionnée, désengagée : aucun de ces adjectifs ne convient à l’observation entre 1750 et 1850. Celle-ci était un talent universel, l’esprit d’observation. L’histoire littéraire de cette aptitude révèle qu’à côté de la subjectivité, écran interposé entre le sujet et l’objet, la science affronta, sous le nom d’observation, le problème redoutable du talent. Plus un individu est observateur, plus il se perfectionne au contact du monde : l’esprit d’observation ne dévoile la vérité qu’en faisant diverger les entendements. Face à ce risque, la méthodologie eut pour fonction de recréer une connivence à partir d’un accord politique sur la différence des esprits. Ces discours parlant d’égalité nourrirent alors une pensée contestataire, de la bohème littéraire du 18e siècle aux socialistes du xixe en passant par les girondins et les libéraux. L’invention de l’objectivité finit par clore les débats, vers 1850, en annulant le génie d’observation au profit d’une substituabilité conventionnelle entre savants. Salutaire par son aspect démocratique, ce règne de la méthode dont nous sommes encore tributaires repose toutefois sur un imaginaire non interrogé : le savoir précéderait le savoir-faire, l’expérience s’acquerrait volontairement, le moi serait indépendant de ses idées… Seule une esthétique réfléchit à ces présupposés : le réalisme. En ne décrivant « que ce que les autres sont à même de voir aussi, afin qu’ils puissent juger en connaissance de cause » (E. Duranty), l’auteur observateur définit un réel commun à partir d’une négociation critique sur les talents : en cela, ces textes sont plus proches de la méthodologie que de la science, et constituent une proposition épistémologique originale.
Le langage du corps tient une place prépondérante dans la communication sociale et ceci dès la petite enfance. L'objectif de ce travail de thèse est de déterminer la contribution du corps en action dans la compréhension des interactions sociales (IS). L'approche développementale nous renseigne sur les mécanismes présidant à sa mise en place chez l'enfant, être éminemment social. En revanche dans l'autisme, trouble neurodéveloppemental complexe, la dimension sociale est altérée. Nos études questionnent dans cette pathologie l'utilisation de l'information portée par le corps en mouvement, dans un contexte social. L'originalité de notre paradigme expérimental repose sur l'utilisation de mouvements humains (MH), ou animations en points lumineux, qui permettent d'isoler l'information sociale portée par le corps en action. Nous avons présenté à nos sujets des scènes visuelles présentant deux acteurs engagés dans une interaction sociale ou pas. Une double approche, comportementale et en IRMf, nous éclaire sur l'utilisation et la mise en place de la simulation motrice et nous permet de questionner son implication dans l'autisme. Nous montrons que les enfants entre 4 et 6 ans et les enfants autistes utilisent les informations visuelles portées par le MH pour comprendre une IS, bien que leurs performances ne soient pas encore optimales. Chez l'adulte, en plus du réseau de la mentalisation attendu, nous avons mis en évidence l'importance du réseau des mécanismes miroirs dans la cognition sociale. Chez l'enfant, l'IRMf nous a permis de rapporter pour la première fois un recrutement fonctionnel précoce du gyrus frontal inférieur, siège du système des neurones miroirs, lors de l'observation des scènes sociales. La discussion générale établit un lien étroit entre la mise en place du mécanisme miroir et la construction des représentations de l'action, elle interroge aussi l'intégrité de ce processus dans l'autisme. En conclusion, ces études ouvrent la voie au rôle fondateur du mécanisme miroir dans le développement social de l'enfant.
Jules Houël (1823-1886) est un mathématicien et astronome français, issu d’une ancienne famille protestante normande. A la fin de ses études à l’École normale en 1846, il débute une carrière mouvementée d’enseignant en lycée. En 1855, il obtient un doctorat dans lequel il applique la méthode des fonctions perturbatrices de Le Verrier à Jupiter et à partir de 1859, il enseigne le calcul différentiel et intégral à la Faculté des sciences de Bordeaux. Dès 1861, Houël abandonne ses recherches astronomiques de sorte que ses publications postérieures sont essentiellement des traductions ou des traités d’enseignement. Il a la particularité d’être polyglotte et d’avoir une grande puissance de travail. Nous montrons comment il arrive à créer des réseaux scientifiques « importants » en Europe, qui lui permettent de diffuser certaines théories par des publications ou/et des correspondances, qui elles-mêmes alimentent ces réseaux, … Certains réseaux ont un cadre lié à une structure (société savante, journal), d’autres sont liés à une thématique ou/et une zone géographique. Nous présentons notamment quatre réseaux européens où Houël joue un rôle de premier plan : celui de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux à partir de 1866, celui de ses correspondants italiens en lien avec les fondements de la géométrie en 1867-1870, celui du Bulletin des sciences physiques et astronomiques dans les années 1870-1883 et le réseau des correspondants scandinaves en lien avec la théorie des fonctions elliptiques sur la période 1870-1885. Nous montrons en outre comment ces réseaux sont liés et les intérêts pour Houël dans chacun de ces quatre réseaux.
In 1882, Richard Dedekind and HeinrichWeber offer an arithmetico-algebraic re-definition of the Riemann surface, using concepts and methods introduced by Dedekind in algebraic number theory. In an attempt to investigate Dedekind’s works beyond the mere idea of a “conceptual approach”, this works proposes to identify the elements of practice specific to Dedekind, starting from the paper co-written with Weber. I put forward the idea that in Dedekind’s works, arithmetic can play an essential and active role in the elaboration of mathematical knowledge. For this, I propose to study, in Dedekind’s mathematical practice, the conception of arithmetic, the place and role of arithmetical notions and the possible evolutions in Dedekind’s ideas about arithmetic. This study is based on a careful analysis of a selection of Dedekind’s texts. For this, I study Dedekind’s early works, his 1854 Habilitationsvortrag and his first works in number theory. Then, I propose a comparison between the first two versions of Dedekind’s theory of algebraic numbers published in 1871 and 1877. Finally, I turn to Dedekind’s foundational works, to make explicit the specificities of his conception and elucidate, through the study of his works on the definition of numbers, what gives arithmetic its pride of place and the link with the definition of natural numbers given in Was sind und was sollen die Zahlen? in 1888.
Dans cette thèse, j'étudie trois thèmes centraux dans la Géométrie cartésienne : le problème de Pappus, le problème des tangentes et des normales, et un problème de gnomonique connu sous le nom de Problema Astronomicum. Par " Géométrie cartésienne ", j'entends le corpus formé par la Géométrie publiée en 1637, ainsi que par la Correspondance cartésienne et les deux éditions latines placées sous la direction de Frans van Schooten publiées respectivement en 1649 et 1659-1661. J'étudie la genèse de la théorie cartésienne des courbes géométriques définies par des équations algébriques à travers les controverses dans la correspondance cartésienne : la controverse avec Roberval sur le problème de Pappus, la controverse avec Fermat sur les tangentes, et la controverse avec Stampioen sur le Problema astronomicum. Je montre que la Géométrie de la Correspondance constitue un moyen terme entre la Géométrie de 1637 et les éditions latines de 1649 et 1659-1661, en pointant les enjeux et les questions associés au concept de courbe algébrique. D'autre part, j'étudie et compare la méthode des tangentes de Fermat et la méthode des normales de Descartes, en les rapportant aux Coniques d'Apollonius.
Entre 1780 et 1860 en Europe, la géographie se structure peu à peu en champ scientifique et académique indépendant, et particulièrement en France, Prusse et Grande-Bretagne. Au même moment dans ces trois pays européens, des géographes travaillent à ce que leur champ soit enfin considéré comme une science à part entière, au même titre par exemple que l'histoire ou les mathématiques. Ils construisent leur champ à la faveur d'un renouvellement profond de ses principes institutionnels et épistémologiques, selon un processus similaire dans ces trois sphères. Ils organisent progressivement les connaissances géographiques selon une exigence de scientificité, dont ils discutent les modalités. Ce processus de construction à la fois scientifique et disciplinaire est profondément marqué par l'héritage des Lumières et l'esprit universaliste, mais, parallèlement, il se trouve également influencé et informé par le contexte politique. Entre 1785 et 1860, les savoirs géographiques sont en effet investis d'une valeur stratégique grandissante : ils jouent un rôle majeur dans les idéologies politiques des États et également dans les actions politiques menées. En interrogeant conjointement les champs du politique et des savoirs géographiques, cette thèse vise ainsi à mettre en évidence en quoi le processus de montée en discipline des savoirs géographiques engagé simultanément en France, en Prusse et en Grande-Bretagne se trouve fondamentalement en tension entre, d'une part, une exigence universaliste portée à l'échelle européenne par le champ scientifique et, d'autre part, la nationalisation progressive des savoirs géographiques.
Cette thèse interroge les représentations que les géographes français du XXe siècle se font de leurs activités de recherche en explorant les multiples significations que recouvre pour eux le terrain, et notamment la place qu'il occupe dans les dispositifs heuristiques et dans l'imaginaire disciplinaire. Cette recherche entend appliquer à l'histoire de la géographie les approches et les méthodes de la sociologie des sciences. Tout au long de la période, le terrain constitue un ordre du discours dominant qui structure durablement les représentations et les pratiques : face aux lectures inspirées par la théorie des révolutions scientifiques, cette thèse met au contraire en lumière la stabilité des discours. La " crise de la géographie " qui désigne la période de doutes que traverse la discipline durant les années 1960 et 1970 apparaît alors davantage comme une mutation des discours et non comme un changement radical des pratiques. Ce changement de focale sur l'histoire de la discipline oblige donc à repenser les cadres avec lesquels l'écrire : le terrain - envisagé comme un " objet scientifique total " - constitue alors une entrée pertinente pour appréhender la géographie dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois ses contenus, ses méthodes, ses finalités et ses acteurs.
La géomatique, c'est-à-dire l'utilisation des technologies numériques pour acquérir, traiter, visualiser et communiquer l'information géographique, comprend de très nombreux domaines d'application dans le monde professionnel. L'usage de ces technologies (système de localisation GPS, globes virtuels sur Internet, systèmes d'information géographique...) commence à se diffuser dans la vie quotidienne et dans le domaine éducatif. Nous nous intéressons ici aux questions posées par l'introduction des outils géomatiques dans l'enseignement de la géographie. L'intégration de la géomatique ne va pas sans poser de nombreuses questions qui relèvent du champ de la géographie, de l'épistémologie, de la didactique, mais aussi de l'informatique, de la cartographie, de la psychologie cognitive, de la sociologie des usages. Elle fait rejouer de vieux débats sur la place et le rôle de la carte dans l'enseignement et l'apprentissage de la géographie, mais pose aussi la question des technologies de l'information géographique comme nouvel outil du géographe, comme manière différente de concevoir, d'enseigner et d'apprendre la géographie. Cette recherche vise d'une part à comprendre les usages et les enjeux de la cartographie et des Systèmes d'Information Géographique en classe de géographie, d'autre part à construire et à expérimenter un SIG éducatif qui favorise différents modes de raisonnement géographique. L'approche s'inscrit dans la perspective de la « genèse d'usages » géomatiques dans l'enseignement secondaire. A travers des démarches d'exploration visuelle et de résolution de problème, mêlant des approches inductives et des approches hypothético-déductives, l'enjeu est de dépasser les pratiques ritualisées et naturalisées de la carte scolaire, afin de promouvoir une nouvelle éducation géographique.
Dans le cadre de cette thèse, nous proposons d'examiner l'approche intuitionniste de l'arithmétique et psycho-physiologique de la géométrie de Poincaré à travers le prisme de la recherche moderne sur le cerveau et la capacité des humains à appréhender le nombre et la géométrie/l'espace. L'objectif de cette analyse est de déterminer si les recherches sur les corrélats neuronaux de l'acquisition des nombres et de la géométrie/l'espace peuvent contribuer à une meilleure compréhension des idées de Poincaré sur les mathématiques, tout en examinant la compatibilité de son approche constructiviste avec l'approche neuroconstructiviste des neurosciences cognitives.À cette fin, nous avons choisi de nous focaliser sur quatre neuroscientifiques cognitivistes : Changeux, Dehaene, Damasio et Berthoz, qui font référence aux idées de Poincaré pour décrire les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la compréhension et l'acquisition du nombre, de la géométrie/l'espace et de la prise de décision. Ainsi, nous examinons l'approche constructiviste de Poincaré, qui admet que l'expérience guide l'activité intuitive de création des nombres, à travers le prisme de l'approche neurocognitive de Changeux et l'intuition du nombre de Dehaene. De même, nous examinons l'approche psycho-physiologique de la géométrie à travers le prisme de l'approche neurophysiologique et cognitive de la géométrie proposée par Berthoz. Enfin, nous confrontons l'hypothèse poincaréienne selon laquelle l'intuition et l'émotion sont des composantes essentielles à l'invention à la théorie des marqueurs somatiques de Damasio.À l'issue de cet examen, une première constatation met en évidence que les neurosciences cognitives renforcent certaines idées de Poincaré sur les mathématiques. Cependant, après une analyse approfondie, nous constatons que les idées fondamentales constituant l'édifice de la philosophie poincaréienne des mathématiques sont incompatibles avec les neurosciences cognitives. Cette incompatibilité s'explique par la volonté des neuroscientifiques cognitivistes d'ancrer les fondements des mathématiques au niveau de l'activité neuronale sous-jacente à l'évolution biologique, tout en défendant un déterminisme se réclamant de la dominance des aspects ontogénétiques sur les prédispositions phylogénétiques. Afin de préserver la liberté créatrice de l'esprit et le conventionnalisme défendus par Poincaré, et pour une compréhension plus large des processus cognitifs sous-jacents à la construction des concepts mathématiques abstraits et à la résolution des problèmes mathématiques complexes, nous prenons du recul par rapport à une telle vision déterministe.
|